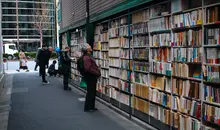Les différences entre les temples bouddhistes et les sanctuaires shintoïstes au Japon
- Publié le : 17/05/2024
- Par : R.A. / J.R.
- Youtube
Le Japon abrite deux grandes religions qui cohabitent depuis des siècles : le shintoïsme, religion animiste autochtone, et le bouddhisme, importé de Chine au VIe siècle. Malgré un certain syncrétisme historique, temples bouddhistes et sanctuaires shinto présentent des différences notables au niveau des croyances, de l'architecture et des usages. Pour le visiteur néophyte, il n'est pas toujours évident de les distinguer au premier coup d'œil. Pourtant, en y regardant de plus près, on remarque des caractéristiques propres à chacun.
Ces deux religions majeures du Japon sont pratiquées par une large majorité de la population. Ainsi, selon les statistiques de 2021, le pays compterait environ 90 millions de shintoïstes et 85 millions de bouddhistes, sachant que beaucoup de Japonais adhèrent aux deux spiritualités. Décryptons ensemble les spécificités des temples et sanctuaires de l'archipel, reflets de cette dualité religieuse unique au monde.
Origines et croyances du bouddhisme et du shintoïsme
Le shintoïsme est la plus ancienne religion du Japon, apparue dès la fin de la période Jōmon. Ses origines se perdent dans la nuit des temps et la mythologie. Il s'agit d'un culte animiste et polythéiste qui vénère une multitude de divinités appelées kami, incarnant les forces de la nature. Montagnes, rivières, arbres, rochers, animaux peuvent être habités par un esprit. Ce panthéon compte aussi les ancêtres divinisés de la famille impériale, censée descendre de la déesse du soleil Amaterasu.
Le bouddhisme a quant à lui été introduit au Japon au VIe siècle, en provenance de Chine via la Corée. Fondé sur les enseignements de Bouddha, il a pour but ultime d'atteindre l'Éveil et de se libérer du cycle des réincarnations. Au fil des siècles, de nombreuses écoles ont vu le jour dans l'archipel, donnant naissance à un bouddhisme spécifiquement japonais. Malgré quelques frictions initiales, shintoïsme et bouddhisme vont longtemps coexister et même se mêler, jusqu'à leur séparation forcée à l'ère Meiji.
Différences architecturales entre un temple bouddhiste et un sanctuaire shinto
L'organisation spatiale et l'apparence des lieux de culte shinto et bouddhistes varient grandement. Un sanctuaire shinto se reconnaît immédiatement à son portail traditionnel en bois ou en pierre appelé torii, souvent peint en vermillon. Il marque l'entrée dans un espace sacré et pur, domaine des kami.
A contrario, l'accès à un temple bouddhiste se fait en passant sous un portique imposant à deux niveaux, le sanmon. Il est fréquemment gardé par deux statues de protecteurs à l'air menaçant, les niō. La structure centrale abrite en général une statue de Bouddha ou d'une autre divinité bouddhique.
Un sanctuaire est composé de plusieurs bâtiments aux toits à pignon caractéristiques. L'ensemble est en bois naturel, avec peu d'ornementations. Le sanctuaire principal (honden) est fermé au public et renferme un objet sacré représentant le kami. L'oratoire (haiden) est l'endroit où les fidèles viennent prier.
Les temples bouddhistes disposent eux-aussi de plusieurs édifices, dont le bâtiment principal (kondō) contenant une effigie sacrée. Une salle de prière permet aux pratiquants de méditer, réciter des sūtras. On trouve souvent une pagode, tour à étages héritée de l'architecture religieuse indienne. Les dimensions sont généralement plus vastes et la décoration plus riche que dans les sanctuaires.
Éléments caractéristiques des sanctuaires shinto : torii, chôzuya, haiden et honden
Outre le fameux torii trônant à l'entrée, plusieurs éléments permettent d'identifier à coup sûr un sanctuaire shinto. Juste après avoir franchi le portail, le visiteur se purifie à un pavillon abritant un bassin, le chôzuya : il s'y lave les mains et la bouche avec une louche avant de pénétrer dans l'enceinte.
Le cœur d'un sanctuaire se compose de deux bâtiments. Le haiden est la salle de prière ouverte aux fidèles. Ils s'y recueillent, font une offrande et sonnent une cloche pour appeler la divinité. Dans le honden, réservé aux officiants, est conservé l'objet du culte incarnant le kami (miroir, relique...). Les deux édifices sont fréquemment reliés par un corridor couvert, le heiden.
Des statues animalières gardent souvent le sanctuaire : les komainu. Il s'agit de deux lions protecteurs placés de part et d'autre de l'entrée. L'un a la gueule ouverte, l'autre fermée, symbolisant la naissance et la mort. Les renards messagers (kitsune) sont quant à eux associés aux sanctuaires d'Inari, kami des récoltes.
Composants typiques des temples bouddhistes : mon, kondō, pagodes, statues et jardins
Un temple bouddhiste frappe par son architecture monumentale. On y pénètre en franchissant un portail à deux niveaux, le sanmon, flanqué de part et d'autre d'intimidants gardiens en bois. Le kondō est la salle principale qui abrite les représentations sacrées de bouddhas et boddhisattvas. Il n'est pas rare qu'un immense Bouddha domine la cour du temple.
Autre élément distinctif : la pagode. Cette tour à étages impairs est l'héritière du stūpa indien. Elle sert de reliquaire et symbolise les étapes vers l'Éveil. Les plus anciennes sont en bois, les plus récentes en pierre. Les toits en forme de dôme sont surmontés d'un pilier ornemental.
Un temple possède généralement un ou plusieurs jardins paysagers, espaces de méditation et de contemplation invitant à faire le vide en soi. Le plus célèbre est sans doute le jardin sec du Ryōan-ji à Kyoto, quintessence du jardin zen avec son tapis de gravier blanc soigneusement râtissé et ses 15 rochers.
Usages différenciés des temples et sanctuaires dans la vie des Japonais
Temples et sanctuaires rythment la vie des Japonais, qui s'y rendent régulièrement prier, mais aussi participer aux nombreuses célébrations et rituels. Ils y vont dès le Nouvel An faire des vœux et tirer leur oracle annuel (omikuji). Les sanctuaires shinto accueillent traditionnellement les cérémonies liées aux moments heureux de l'existence.
On y fête la naissance, les 3, 5 et 7 ans des enfants (shichi-go-san), la majorité à 20 ans (seijin shiki). C'est aussi le cadre privilégié pour les mariages à la japonaise. À l'inverse, les temples bouddhistes sont associés au deuil, puisqu'ils abritent souvent un cimetière et un columbarium dans leur enceinte.
Les Japonais sollicitent la bénédiction des kami shinto pour les étapes fastes de la vie et les événements positifs : entrée à l'université, recherche d'emploi, grossesse, achat d'une voiture ou d'une maison... Les divinités bouddhistes sont davantage priées pour la guérison d'un proche ou la réussite à un examen.
En définitive, shintoïsme et bouddhisme couvrent tous les aspects de l'existence. Certains sanctuaires et temples sont spécialisés et très populaires pour un type de vœu, comme Meiji-jingū à Tokyo, haut lieu des mariages shinto, ou le Yasukuni-jinja, consacré aux mânes des soldats morts pour la patrie.
Une cohabitation religieuse singulière dans la société japonaise contemporaine
Depuis des siècles, le shintō et le bouddhisme forment la matrice spirituelle de la société japonaise, en se complétant harmonieusement. Si la pratique religieuse régulière concerne de moins en moins de fidèles, la grande majorité des Japonais continuent à fréquenter sanctuaires et temples pour les grandes étapes et célébrations, perpétuant ainsi des rites millénaires.
Dans de nombreux sanctuaires shinto, on trouve encore trace de la fusion historique des deux religions. Ainsi le Hiyoshi-taisha près du lac Biwa possède deux sanctuaires jumeaux, l'un pour les kami d'Inari, l'autre pour un boddhisatva. Le célèbre Itsukushima-jinja à Miyajima intègre une pagode à 5 étages.
Cette perméabilité entre shintoïsme et bouddhisme se retrouve également dans les croyances et superstitions populaires. Beaucoup de Japonais possèdent chez eux un "coin sacré" avec un autel des ancêtres bouddhiste (butsudan) et une étagère dédiée aux kami (kamidana). Autre exemple révélateur, le rituel de prière shinto inclut l'usage d'un chapelet, objet typiquement bouddhiste !
Au final, la dualité religieuse du Japon offre au visiteur une fascinante plongée au cœur de l'âme et de l'identité nippones. Entre traditions séculaires et emprunts mutuels, sanctuaires shinto et temples bouddhistes sont des lieux incontournables pour saisir toute la profondeur spirituelle de la culture japonaise. Des trésors d'architecture et d'histoire, mais aussi et surtout des espaces de recueillement et de communion avec le sacré, vibrant d'une énergie unique.
Alors, que vous soyez en quête de dépaysement, de beauté ou de sérénité, ne manquez pas de faire étape dans ces sites exceptionnels qui révèlent toute la singularité de la foi à la japonaise. Pour ne rien perdre de leur magie et vous imprégner pleinement de leur atmosphère, adoptez les gestes et attitudes de circonstance, comme les Japonais eux-mêmes le font depuis la nuit des temps.