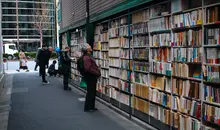Torii, le portail sacré du Japon
- Publié le : 02/01/2024
- Par : S.R. / I.D.O.
- Youtube

Torii au Japon
MustangJoe
Qu'est-ce qu'un torii et quelle est sa signification ?
Un torii (鳥居) est un portail traditionnel japonais que l'on trouve généralement à l'entrée des sanctuaires shintoïstes. Il marque la frontière entre l'espace profane et l'enceinte sacrée du sanctuaire. Le torii est devenu un des symboles les plus emblématiques du shintoïsme et du Japon.
Le mot "torii" signifie littéralement "là où se perchent les oiseaux". Selon la mythologie, les oiseaux seraient des messagers des dieux. Les torii serviraient donc de perchoir aux envoyés divins lorsqu'ils descendent sur terre.
Franchir un torii signifie pénétrer dans un espace pur et sacré. C'est un acte symbolique fort de respect et de purification avant d'approcher les kamis, les divinités shintoïstes. Les visiteurs se courbent par respect en passant sous un torii.
Les origines et l'histoire des torii
L'origine exacte des torii est assez floue et plusieurs théories existent. Certains pensent qu'ils auraient été inspirés par les portiques sacrés indiens et népalais appelés "torana".
Mais une légende populaire issue du Kojiki, un recueil de mythes fondateurs du Japon datant du 8ème siècle, donne une autre explication. La déesse du soleil Amaterasu, fâchée contre son frère, se serait enfermée dans une grotte, plongeant le monde dans l'obscurité. Pour l'attirer à l'extérieur, les autres divinités auraient installé des coqs sur un perchoir devant l'entrée de la grotte. Le chant des volatiles aurait fini par faire sortir Amaterasu. Comme "tori" désigne les oiseaux en japonais, cette histoire expliquerait le nom et la fonction originelle des torii en tant que perchoirs pour les messagers divins.
Les premiers torii dateraient du 10ème siècle. À l'origine, les sanctuaires étaient simplement délimités par des cordes tendues entre des poteaux. Progressivement, la structure en bois du torii s'est généralisée pour marquer distinctement le seuil du domaine des kamis.
Les différents types de torii et leurs caractéristiques
Malgré une forme de base commune, il existe une grande variété de styles de torii. On les classe en deux grandes catégories :
- Les torii droits, appelés shinmei torii (神明鳥居), qui comportent 5 variantes principales. Le plus célèbre est le style Ise, aux lignes épurées, que l'on trouve notamment au grand sanctuaire Ise-jingū.
- Les torii aux lignes courbes, appelés myōjin torii (明神鳥居), qui comprennent 6 variantes. Le plus connu est le style Inari avec ses deux traverses recourbées vers le haut, fréquent aux sanctuaires dédiés à Inari, kami du riz et de la prospérité.
Un torii standard comprend deux piliers verticaux (hashira) qui supportent deux linteaux horizontaux, le kasagi en haut et le nuki en bas. Des tasseaux de renfort peuvent relier les éléments. L'ensemble repose sur une base en pierre appelée kamebara.
Le bois est le matériau le plus traditionnel, mais il existe aussi des torii en pierre, en bronze, voire en béton ou en acier de nos jours. La plupart sont peints en rouge vermillon, couleur sacrée qui repousserait les mauvais esprits. Leur base est parfois de couleur noire.
- À lire aussi : Sanctuaires shinto à voir absolument
Le rôle des torii à l'entrée des sanctuaires shinto
Un torii se dresse généralement à l'entrée d'un sanctuaire shinto pour délimiter l'enceinte sacrée. Il peut aussi marquer le départ d'un chemin de pèlerinage ou l'accès à un lieu naturel vénéré comme une montagne sacrée.
Parfois, une série de torii jalonne le sandō, l'allée qui mène au pavillon principal. Chaque torii franchi indique un niveau de sainteté croissant à mesure que l'on s'approche de la divinité.
Passer un torii est un acte symbolique qui demande le respect d'un certain protocole. Il faut d'abord se purifier les mains et la bouche au pavillon d'ablutions. Ensuite, devant le torii, on s'incline une fois en signe de salut et de respect aux kamis avant de le franchir.
Selon la coutume, on doit aussi éviter de marcher au centre du passage sous le torii, cet espace étant en principe réservé aux divinités. Mieux vaut donc traverser légèrement sur le côté.
Comment se comporter face à un torii selon les traditions
La coutume shintoïste veut que l'on entre et sorte du sanctuaire par le même torii, afin de revenir correctement dans le monde profane après avoir été en contact avec le sacré. Certains visiteurs préfèrent donc contourner le torii s'ils ne sont pas certains de repasser par le même chemin.
Franchir un torii engage à adopter une conduite pure et respectueuse dans l'enceinte du sanctuaire. Il convient de parler calmement et de maintenir les lieux propres.
Il faut également veiller à ne pas poser ses mains sur les piliers ou s'appuyer contre les torii par égard pour ces portiques vénérables qui accueillent le passage des divinités.
De même, par respect pour le caractère sacré du lieu, il est d'usage d'éviter de prendre des photos sous le torii ou de dos quand on l'a franchi. On se place de préférence de côté pour les clichés souvenirs.
Quelques torii emblématiques à découvrir au Japon
Parmi les milliers de torii présents au Japon, certains sont particulièrement renommés pour leur beauté, leur taille, leur ancienneté ou leur emplacement original :
- Le grand torii flottant du sanctuaire d'Itsukushima sur l'île de Miyajima, qui semble émerger des flots à marée haute et fait partie des "trois plus beaux paysages du Japon".
- Les milliers de torii vermillon du Fushimi Inari Taisha à Kyoto, qui forment de longs tunnels photogéniques le long des sentiers de la montagne sacrée d'Inari.
- Le torii en bois de cyprès vieux de 1000 ans du sanctuaire Meiji à Tokyo.
- Le grand torii en pierre immergé du sanctuaire de Hakone au bord du lac Ashi, avec le mont Fuji majestueux en arrière-plan.
- Le torii géant de 25m de haut du sanctuaire Heian à Kyoto.
Le torii, un symbole incontournable de la culture japonaise
Emblème du shintoïsme et du Japon, le torii s'est exporté bien au-delà de l'archipel. On retrouve aujourd'hui ce symbole un peu partout dans le monde sur des affiches, des logos, des objets… évoquant instantanément le pays du Soleil Levant.
L'esthétique épurée de cette arche élégante et son aura spirituelle lui confèrent un pouvoir d'évocation universel. Image de sagesse et de paix intérieure, le torii invite au recueillement, au lâcher-prise et au respect de la nature, des valeurs essentielles du shintoïsme qui inspirent partout.
Certains torii construits à l'étranger sont même devenus de véritables attractions locales, comme celui du Japanese Tea Garden à San Francisco ou celui du parc oriental Maulévrier en France.
Que ce soit au Japon devant un authentique sanctuaire ou ailleurs dans le monde devant une réplique décorative, passer un torii reste un expérience symbolique forte qui relie à la culture et aux traditions millénaires nippones.
Faire don d'un torii : une pratique courante pour obtenir la bénédiction des dieux
Au Japon, il est courant pour des particuliers ou des entreprises de faire don d'un torii à un sanctuaire en échange des bienfaits des kamis. Le nom du donateur, la date et parfois un vœu y sont alors inscrits.
Cette pratique appelée kiganbun permet aux sanctuaires de renouveler régulièrement leurs nombreux torii grâce aux dons des fidèles. C'est aussi pour les donateurs un acte de piété et de générosité censé leur attirer la protection divine.
Le coût d'un petit torii votif avoisine les 400.000 yens (~3000€). Mais les plus grands torii peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions de yens. Ce geste pieux constitue donc un investissement conséquent mais gratifiant.
Les longues allées de torii comme au Fushimi Inari Taisha sont le fruit de multiples dons de ce type. En contrepartie de son offrande, le donateur peut y faire calligraphier discrètement son nom sur les montants du torii. C'est une forme de réclame et de fierté que d'avoir son "propre" torii dans un lieu saint très passant.
Quand un torii est abîmé par les intempéries, il sera là aussi remplacé par un nouveau grâce aux dons. L'ancien portail sacré sera alors brûlé rituellement ou entreposé respectueusement à l'écart.
Ces dons et renouvellements permanents assurent aux torii une présence pérenne dans le paysage des sanctuaires japonais depuis des siècles, pour le plus grand plaisir des kamis et des visiteurs.